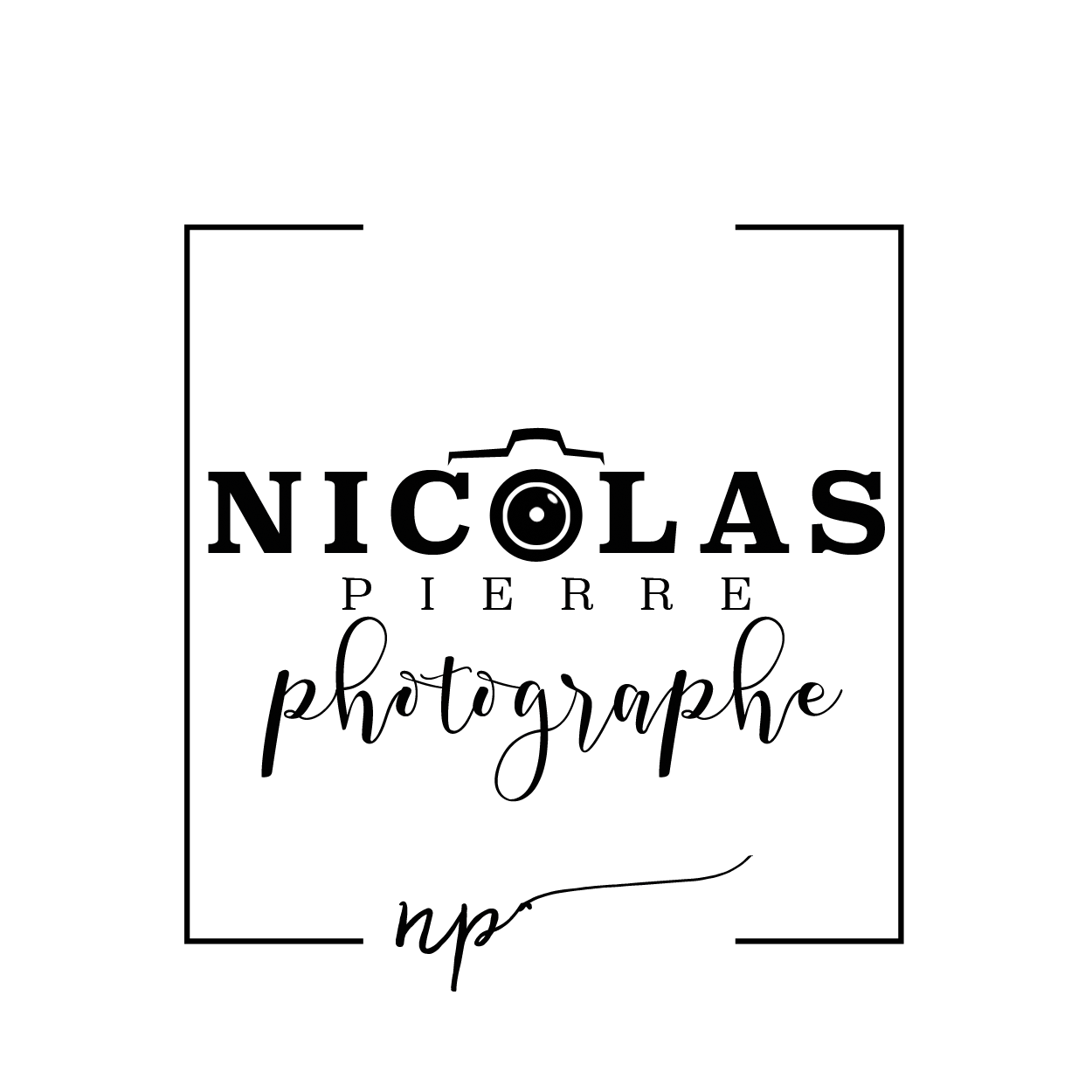5 octobre 2025 / Non classé
Octobre Rose à Samer et Boulogne Sur Mer
Quand des femmes posent avec des armes blanches pour parler du cancer du sein
Une réalité qui nous touche tous :
Il suffit de regarder autour de soi pour comprendre que cette maladie n’est jamais bien loin. Dans chaque famille, dans chaque cercle d’amis, il y a presque toujours une femme dont l’histoire se confond avec le mot “cancer du sein”. Parfois c’est une tante, parfois une collègue, parfois une amie dont le sourire masque des mois de combat.
Les chiffres confirment ce ressenti : plus d’une femme sur douze sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Douze pour cent. Un chiffre glaçant, qui traduit l’ampleur du fléau.

Et pourtant, dans cette statistique effrayante se cache aussi une note d’espoir. Car lorsque la maladie est dépistée tôt, les chances de guérison sont très élevées. C’est pourquoi le dépistage régulier n’est pas un simple rendez-vous médical, mais un geste vital. Pourtant, trop de femmes repoussent encore cette étape. Par peur, bien sûr, mais aussi par cette conviction que “cela n’arrive qu’aux autres”. Et parfois, simplement, parce qu’il est difficile de franchir le pas et d’accepter de se dénuder devant un médecin lorsque l’on ne se sent pas malade.
Ces freins invisibles, mais puissants, sont autant d’obstacles à la prévention. Et c’est pour les bousculer qu’est né ce projet.
Des armes pour symboliser la lutte.
C’est Alexandre, Professeur d’escrime à Samer ( association :https://www.facebook.com/profile.php?id=100085140426256 ) et mari d’une amie modèle, qui m’a soufflé l’idée. Pourquoi ne pas associer photographie et escrime ? Pourquoi ne pas demander à des femmes de poser avec des armes blanches ?

À première vue, l’idée pouvait sembler déroutante. Mais rapidement, elle a pris sens. Car l’arme n’est pas qu’un objet de métal : elle incarne le courage, la force, la défense, le combat. Elle dit autant la vulnérabilité que la puissance. Elle est une extension symbolique de ce que signifie “lutter”.
Les premiers essais : une désillusion fondatrice
Avec trois volontaires, nous avons tenté une première série de tests. Mais mes choix techniques furent malheureux. J’avais opté pour une grande source de lumière frontale : le résultat fut plat, sans relief. J’avais choisi des portraits trop serrés : les armes perdaient leur sens. Et j’avais utilisé un fond rose, croyant coller à l’esprit d’Octobre Rose : le résultat sombrait dans la facilité.

À la fin de cette séance, le constat était amer. Les images manquaient de force, de densité, de souffle. Je me suis demandé si ce projet ne nous dépassait pas. Mais parfois, l’échec est une étape nécessaire. Il oblige à se recentrer, à épurer, à chercher plus juste.
Le rebond : trouver le ton juste
Nous avons décidé de recommencer. J’ai repris mes fondamentaux : un fond marron, sobre et intemporel, qui laisse les corps respirer ; des lumières sculptantes, pour redonner du volume et de l’intensité ; des cadrages plus amples, laissant place aux gestes et aux postures.

Pendant trois heures, avec trois modèles aux morphologies différentes, nous avons exploré. Les images se sont construites peu à peu, avec patience et rigueur. Cette fois, la force était là. Les femmes paraissaient dignes, puissantes, déterminées. Nous avions trouvé notre voie.
Convaincre des volontaires : une aventure humaine
Restait à convaincre des femmes de participer à ce projet. Ce n’était pas la partie la plus simple. Car poser devant un objectif intimide déjà ; poser seins nus, pour une exposition publique, peut effrayer davantage.
Avec l’association, nous avons multiplié les initiatives : création d’événements Facebook, diffusion des images du second test, prises de contact personnelles avec des femmes intéressées pour répondre à leurs doutes. Certaines craignaient de devoir se déplacer à Samer, d’autres redoutaient le regard porté sur leur image, d’autres encore hésitaient face à l’idée de se dénuder. Petit à petit, nous avons levé ces freins.

La veille de la grande séance, 13 femmes avaient accepté de poser. Un chiffre qui, compte tenu du délai, ( onze jours pour tout mettre en place ) relevait presque de l’exploit.
Le jour J : un joyeux désordre plein de dignité
Le 6 septembre, Le lieu de la séance résonnait d’une effervescence douce. L’association accueillait les participantes, café et sourires à l’appui, tandis qu’Alexandre présentait les armes et leur symbolique. Puis venait le moment tant attendu et/ou tant redouté : entrer dans la lumière et poser.
Chaque séance durait une dizaine de minutes. Pas plus. Ce choix permettait de respecter le temps de chacune, d’éviter les retards, de garder une dynamique fluide. Mais cela m’imposait une gymnastique particulière.
En dix minutes, il fallait saisir l’énergie du modèle, la mettre en confiance, comprendre si elle riait facilement ou si elle avait besoin d’être rassurée, et ajuster tout mon comportement en conséquence. D’ordinaire, j’ai une heure pour installer cette relation. Ici, je devais capter l’essentiel et m’adapter.

Et malgré ces contraintes, quelque chose de fort s’est produit. Certaines femmes sont venues avec une amie, d’autres avec un membre de leur famille. L’atmosphère oscillait entre sérieux et légèreté, concentration et rires.
Au total, Treize femmes ont posé. treize histoires différentes, mais une même détermination.
Le choix des images : redonner la décision aux modèles
Lorsque la séance fut terminée, un autre temps a commencé : celui des retouches. Devant mon écran, je retrouvais ces visages et ces corps que j’avais photographiés.
J’ai pris le temps de travailler trois ou quatre images par personne, avec soin en cherchant toujours à sublimer sans trahir la réalité .

Une évidence s’est imposée : je ne devais pas décider seul des photos qui seraient exposées. Car il ne s’agissait pas de mon corps, mais du leur. Pas de mon courage, mais du leur. Pas de mon histoire, mais de la leur.
Laisser aux participantes le choix des images finales n’était pas une simple politesse, c’était une question d’éthique. Comment aurais-je pu, à leur place, décider ce qui allait être montré publiquement, ce qui allait figurer sur les murs d’une exposition que des dizaines de personnes allaient parcourir ?
Je leur ai donc transmis les images retouchées, en leur demandant de choisir celles qu’elles souhaitaient voir présentées. Car ce choix n’était pas anodin : il revenait à s’approprier pleinement son image, à dire “oui” à une photographie qui allait être accroché dans un lieu d’exposition.

Leurs réponses m’ont touché bien au-delà de ce que j’imaginais. Toutes, sans exception, se sont dites fières. Certaines m’ont confié avoir découvert dans ces clichés une beauté qu’elles ne soupçonnaient pas. D’autres ont reconnu une force qu’elles ne pensaient pas posséder.
Montrer ou cacher ? Le débat nécessaire
La question est revenue à plusieurs reprises, parfois à voix haute, parfois en filigrane : fallait-il montrer les photos où la poitrine apparaissait clairement ? Nous savions que l’exposition allait se tenir dans une maison médicale, un lieu de passage, ouvert à toutes et à tous, où des enfants, des familles, des personnes de tous âges viendraient pour des consultations, parfois dans des moments de fragilité. Était-ce le bon endroit pour confronter les visiteurs à des images de nudité, même partielle ?
Certains craignaient que cela choque, que cela suscite des réactions de rejet ou d’inconfort. Après tout, notre société est paradoxale : elle accepte sans sourciller la nudité dans la publicité, souvent sexualisée, mais peine à tolérer la nudité lorsqu’elle est dénuée de tout érotisme, lorsqu’elle se veut simplement humaine, médicale, sensible. Le sein est omniprésent dans les vitrines et sur les écrans, mais il devient presque scandaleux dès lors qu’il est montré pour ce qu’il est : un corps qui vit, un corps qui souffre parfois, un corps qu’il faut protéger.

Pour moi, au contraire, il aurait été incohérent de cacher ces images. Comment parler du cancer du sein en occultant ce qui en est l’objet même ? Comment sensibiliser tout en continuant à entretenir le tabou ? Ne rien montrer, c’était donner raison à l’idée que le sein est un objet essentiellement sexuel, et qu’il doit rester caché dès lors qu’il n’entre pas dans ce cadre. Or, ce projet n’avait rien d’érotique. Il ne s’agissait pas de séduire, mais de témoigner. Ces femmes posaient avec courage, non pour attirer un regard, mais pour en détourner un autre : celui du déni.
La tolérance, me semble-t-il, ne peut pas être à sens unique. Elle suppose d’accepter que d’autres puissent voir différemment, que la nudité ne soit pas forcément un scandale mais parfois un langage nécessaire.
Car il ne s’agissait pas ici d’une exposition artistique, mais d’une campagne de sensibilisation. La nuance est essentielle. Une campagne a pour but d’interpeller, parfois de déranger, toujours d’éveiller les consciences. Le corps nu, dans ce contexte, n’était pas un objet d’esthétique gratuite, mais un rappel brut : c’est bien ici que frappe la maladie, c’est bien ici que le dépistage peut sauver des vies.
J’ai pris le soin de demander l’avis de la maison médicale. La coordinatrice a consulté médecins et infirmières. Leur réponse fut unanime : aucune objection. Ces photos n’étaient ni vulgaires ni déplacées. Elles étaient dignes, respectueuses, fortes. Elles montraient des femmes debout, déterminées, et non des corps exposés.

Ce projet, à sa manière, portait donc une double mission. Sensibiliser au dépistage du cancer du sein, certes. Mais aussi, peut-être, réapprendre à regarder un corps sans le réduire à des codes imposés. À voir dans un sein non pas un objet de désir ou de gêne, mais une part de notre humanité partagée.
Une exposition coûte cher, mais la cause le mérite
Derrière les images et l’émotion, il y a aussi une réalité plus concrète : une exposition coûte cher. Les tirages, les encadrements, la logistique représentent des frais importants. Quelques mécènes nous ont soutenus, mais nous avons dû investir aussi de nos propres moyens. Parce que cette cause le mérite. Parce que certaines batailles ne se comptent pas en euros, mais en convictions.

Conclusion : une aventure humaine avant tout
Au-delà des images, ce projet est une aventure humaine. Une chaîne de solidarité, une sororité qui s’est exprimée à travers les visages et les corps de 14 femmes. Chacune, à sa manière, a tendu la main aux autres. Chacune a montré que la peur peut être surmontée, que les tabous peuvent être bousculés, que la dignité se trouve parfois dans le simple fait d’oser.
Et si, grâce à elles, une seule femme décide d’aller se faire dépister, alors tout cela aura eu un sens.

👉 Exposition Octobre Rose
📍 Maison de la Santé, 108 rue Simone Veil, Samer
📅 Du 3 au 30 octobre 2025
🎀 Avec l’association Atelier aux Mille Armes